|
C'est
au cosmographe François
de Belleforest
que nous devons la première description de Gargas en
1575.
Cet humaniste y suspectait un lieu souterrain « où
jadis nos pères idolâtres alloyent sacrifier ou
à Vénus ou aux dieux infernaux ». Comme l'attestent
de nombreux graffitis sur les parois, toutes les galeries de
Gargas ont été fréquentées par curieux
et promeneurs dès cette époque.
Au
XIXe siècle, la Commune d'Aventignan met un guide à
la disposition des touristes « en voyage aux Pyrénées
».
Le site est une destination prisée des curistes qui fréquentent
les eaux thermales de Bagnères de Luchon ou Cauterets.
Parmi eux, quelques érudits que passionnent la géologie,
la paléontologie ou l'archéologie.
|
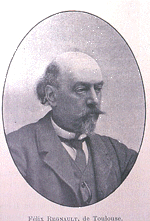
Félix Régnault
|
A
l'image d'Edouard Piette à Lortet, Félix Garrigou
et André de Chasteigner réalisent un sondage au
bas de l'entrée inférieure. Ils découvrent
des vestiges d'une fréquentation humaine qu'ils attribuent
à l'Age du Renne. Par la suite, Félix
Régnault
reprend ces fouilles à plusieurs reprises. Il confirme
l'intérêt archéologique de Gargas et fait
débuter sa fréquentation par les hommes du paléolithique
à l'Age de l'Ours. Aidé de plusieurs ouvriers, il
vide le puits
des oubliettes
des squelettes
d'ours
et de hyènes des cavernes qui y sont morts, probablement
piégés par les eaux. Plusieurs spécimens
sont exposés dans les muséums d'histoire naturelle
de Paris et Toulouse qui contribuent à la renommée
de Gargas. |
|
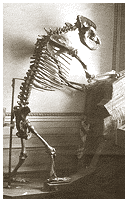
|
Le
11
juin 1906,
alors qu'il connaît la grotte depuis près de trente
ans, Félix
Régnault découvre fortuitement trois mains rouges
peintes en négatif sur la paroi d'un imposant relief
stalagmitique au centre de la grotte.
Il
tait sa découverte, poursuit sa recherche et commence
l'inventaire de ces figures inédites. Il expose ses premières
observations au congrès pour l'avancement des sciences
réunis à Lyon. Cette découverte suscite
la curiosité de celui qui domine déjà la
communauté des préhistoriens, le jeune abbé
Breuil.
|

Mains rouges de la découverte
|
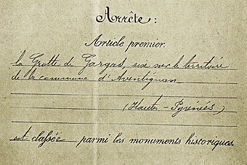 |
Ensemble,
ils recensent près d'une centaine mains et découvrent
les premières gravures faites au doigt sur l'argile des
voûtes de la Grande Salle. En
raison de l'intérêt de ces découvertes, Gaston
Doumergue, ministre de l'instruction publique, classe Gargas parmi
les monuments
historiques (9 avril 1910).
Un an plus tard, l'abbé Breuil dirige l'équipe qui
réalise la première fouille d'envergure au pied
du talus d'entrée de Gargas I et commence le relevé
des gravures pariétales découvertes dans le Camarin.
Tous ces travaux ne furent publiés qu'après 1950.
Entre-temps la grotte fut aménagée pour le public
et reçut un grand nombre de visiteurs. |
| Durant
les années soixante, André
Leroi-Gourhan,
le docteur Ali Sahly et le père Verbrugge publient chacun
une étude des mains de Gargas et proposent leur interprétation
des doigts incomplets. Entre
1973 et 1976, Claude Barrière, assisté des étudiants
de l'Université de Toulouse, entreprend le relevé
l'ensemble des figures préhistoriques.
Il les publie sous la forme d'une monographie. Elle demeure la
référence pour les gravures, heureusement complété
par l'étude critique et l'inventaire détaillé
des mains proposés par Marc Groënen (1986-1988).
Les
découvertes récentes des grottes ornées
Cosquer et Chauvet conduisent les chercheurs à revoir
certaines de leurs interprétations de l'art rupestre.
Gargas bénéficie de ce renouveau de la discipline.
Plusieurs découvertes
secondaires ont pu être faites au cours des années
quatre-vingt-dix : ponctuations, os fichés dans les parois,
gravures et peintures. De même des analyses
de pigment et des datations
ont été réalisées à propos
des mains qui complètent nos connaissances.
|
|

